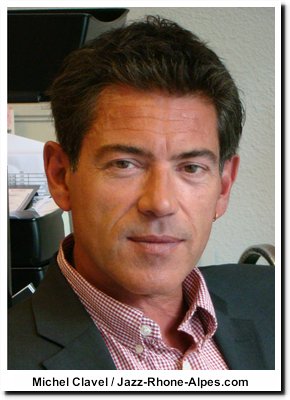Coups de cœur de saison(s)
Les très bons disques commencent à s’accumuler et il est temps de reprendre, après un premier jet fin septembre, le fil de mes sélections tant parmi les dernières nouveautés qu’en revenant à quelques latences du trimestre dernier. Pour ce second volet très éclectique même s’il aligne trois pianistes mais pas que, on démarre avec le dixième opus du songwriter danois et chanteur multi-instrumentiste Mike Andersen au sommet de son art, avant de retrouver le charme irrésistible du légendaire Ben Sidran bien entouré en live au Sunside. Autre légende honorée par le duo italien Giovanni Ceccarelli- Ferruccio Spinetti, Michel Legrand se voit revisiter avec finesse par ce délicat attelage qui convoque un beau panel de voix, tandis que les claviers de Charlotte Reinhardt escortée par un trio de pointures nous embarquent dans un voyage onirique et contemplatif où la franco-espagnole re-déroule ses Fables( 2024) agrémentées de quatre pièces inédites. Que du bon !
MIKE ANDERSEN «All out of Love» (Custom Records / Baco Music)
 Présent par ailleurs sur le dernier album de Jean-Jacques Milteau, je n’ai découvert Mike Andersen qu’en 2022 en chroniquant ici avec intérêt «Raise Your Hand», album mid-tempo acoustique et mélancolique révélant à ceux qui comme moi l’ignoraient, le talent mélodique de ce songwriter multi-instrumentiste, star des pays scandinaves et référence de la scène blues du Danemark, son pays.
Présent par ailleurs sur le dernier album de Jean-Jacques Milteau, je n’ai découvert Mike Andersen qu’en 2022 en chroniquant ici avec intérêt «Raise Your Hand», album mid-tempo acoustique et mélancolique révélant à ceux qui comme moi l’ignoraient, le talent mélodique de ce songwriter multi-instrumentiste, star des pays scandinaves et référence de la scène blues du Danemark, son pays.
Trois ans après, suite à un divorce qui l’aura profondément marqué, Mike Andersen nous revient, pour ce déjà dixième album, au sommet de son art, avec «All out of Love» où le compositeur à l’inspiration instinctive s’appuie une fois encore sur les arrangements soignés du pianiste Christian Ki. Dix chansons originales qui parcourent son paysage émotionnel aussi variable et contrasté que la diversité des références musicales qui constituent sa large palette.Outre ses musiques imprégnées par l’héritage anglo-saxon et notamment américain, c’est particulièrement sa superbe voix, toujours très adéquate, qui nous remémore avec bonheur toute une galerie de chanteurs mythiques de nos chères années 70-90.
La voix et les riffs insistants de guitare du titre éponyme en intro, avec son ambiance bluesy quasi sépulcrale par ses touches de cordes et de backing-vocals, nous rappelle le talk-over d’un Leonard Cohen ou d’un Tom Waits. Le single Don’t waste your Time qui suit ressuscite à merveille les eighties avec de belles guitares aux tourneries speed et au son circulaire, entre pop, rock et new-wave, et la voix chaleureuse celle des Bowie (période Low), Robert Palmer, Chris Isaac, en ayant un petit quelque chose dans le son du Gaby de Bashung.
Après la ballade cool Only for You en guitare-voix typique de la country-folk U.S, le plus sombre Souls on Fire s’enfonce plus en profondeur en jouant des delays pour ausculter sa peine. Autre ballade cette fois plus soul-R&B, le sensuel Before I was Good avec ses choeurs sixties séduit par son charme suranné, prélude à deux merveilleuse pépites qui suivent. Entre orgue (Palle Hjorth) et guitare, Falling for You est le slow qui tue avec une mélodie qui nous semble vite familière et de superbes variations harmoniques entre orgue et voix. Feeling de crooner et douceur salace, Andersen est ici dans la veine des Sam Cook et surtout Ray Charles auquel on ne peut que penser, jusqu’à émettre ce petit rire en coin si fameux.
Quant à Haïtian Lady (avec des chœurs féminins haïtiens comme sur Before I was Good), c’est ici le refrain qui tue, un bijou de west-coast avec glockenspiel et guitare totalement dans l’esprit Fagen-Steely Dan et ce groove nonchalant qu’on adore tant. On reste bien en Amérique mais en s’enfonçant dans le Sud profond avec Big Mouth, râpeux comme le talking blues hypnotique d’un John Lee Hooker. Et puis virage encore, avec le gros son du synthé basse pour Clean House, du blues-rock avec toujours un beau travail de son sur la voix, qui tabasse et envoie le bois à la façon des tatoués Italiens de Superdownhome, avant d’achever ce riche périple émotionnel en solo intégral voix-guitare sur le plus bref Pack your Bags.
Diversité et raffinement puisant au meilleur, voilà franchement un superbe album signature !
BEN SIDRAN «Are we there yet» Live at the Sunside (Bonsaï Music / Socadisc/ Idol)
 Il y a deux ans, le légendaire pianiste américain fêtait ses quatre-vingts printemps en réunissant à Paris, sous l’égide de son label Bonsaï Music, une belle brochette de musiciens en studio pour enregistrer le merveilleux album «Rainmaker» qui a figuré en bonne place dans mon Best-Of 2024. Un an plus tard, c’est un nouvel album qui vient nous enthousiasmer, d’autant qu’il s’agit d’un live -encore à Paris, enregistré mi-juin 2024- pour un artiste que nous n’avons pas la chance de voir en concert quand on est provincial. Il faut dire que Ben Sidran a ses habitudes puisqu’il vient rituellement dans la capitale chaque année depuis 1999, toujours au Sunside, donner une petite série de concerts en forme de revue de presse musicale sur l’état de notre civilisation,et où, entre jazz et blues, l’homme lucide et manieur d’ironie régale ses fidèles avec son fameux spoken-word désormais devenu si actuel avec le rap et le hip-hop.
Il y a deux ans, le légendaire pianiste américain fêtait ses quatre-vingts printemps en réunissant à Paris, sous l’égide de son label Bonsaï Music, une belle brochette de musiciens en studio pour enregistrer le merveilleux album «Rainmaker» qui a figuré en bonne place dans mon Best-Of 2024. Un an plus tard, c’est un nouvel album qui vient nous enthousiasmer, d’autant qu’il s’agit d’un live -encore à Paris, enregistré mi-juin 2024- pour un artiste que nous n’avons pas la chance de voir en concert quand on est provincial. Il faut dire que Ben Sidran a ses habitudes puisqu’il vient rituellement dans la capitale chaque année depuis 1999, toujours au Sunside, donner une petite série de concerts en forme de revue de presse musicale sur l’état de notre civilisation,et où, entre jazz et blues, l’homme lucide et manieur d’ironie régale ses fidèles avec son fameux spoken-word désormais devenu si actuel avec le rap et le hip-hop.
En septet, où l’on retrouve bien sûr tous les piliers présents sur « Rainmaker », avec ici en sus Moses Patrou aux percussions et choeurs, le boss est entouré de son fils Leo Sidran à la batterie ainsi que deux autres américains Rick Margitza au sax et Billy Peterson à la contrebasse, et des Parisiens Max Darmon à la basse et Romain Rousoulière à la guitare électrique. Soit deux bassistes, ce qui est assez rare. Au menu de la track-list, treize titres dont quatre pépites de « Rainmaker » et du neuf dans la même veine.
Le titre éponyme ouvre le bal avec un groove de la rythmique qui tombe d’emblée, souligné par quelques traits de sax avant qu’il ne s’échappe en solo. Avec I Might Be Wrong, sorte de tango-jazz qui va verser bossa, on se verrait bien siroter un flip au bar du Savoy ou du Ritz.
Après sa longue intro en talk-over où le fin observateur et critique de notre société a des choses à raconter, Picture Him Happy qui s’étire sur huit minutes prend un rythme latino-cubain avec les percussions de Moses Patrou. Un tempo métronomique toujours propice aux solos de sax, dans une mise en place générale millimétrée. Comme sur Are we there yet, la ligne de basse de Max Darmon fait groover Times Gettin’ Tougher où dialoguent guitare et piano, bien dans l’esprit west-coast de Fagen et Steely Dan (encore !). Le doigté de leur vieux compatriote n’a rien perdu de sa souplesse face au clavier, et ça chaloupe sensuellement sur Don’t cry for no hipster où au piano taquin répond un sax aguicheur.
Du swing et toujours cet humour sarcastique sont au menu du délicieux Drop me off in Harlem (emprunté à Duke Ellington) puis sur Take a little Hit. Nettement plus pop avec une rythmique plutôt rock, Thank God for the F Train balance et prend bien, avant que le tempo boogie-blues de Someday Baby vous donne envie de croiser les mains et les genoux.
Parmi les titres tirés du dernier album studio, on aime particulièrement la nonchalance désabusée du bluesy Ever since the World ended (écrit par Mose Allison), et surtout le groove typique west-coast de Panda, avec son superbe sax en liberté puis un gros tricot de contrebasse boisée en solo, et enfin celui, insouciant et léger, de Victime de la mode avec cette version live très sympa et pleine de fraîcheur guillerette qui donne envie de danser. J’ignore si c’est ce qu’ont fait les spectateurs de cette heure passée en compagnie de l’excellent septet lors de ce live qui se clôt par le piano solo et nostalgique sur Time Waits (un dernier jeu de mot…), mais ils ont eu bien de la chance «d’y être». On se consolera en tout cas avec cette réjouissante trace sonore que Leo Sidran est allé mixer à Brooklyn avant qu’elle nous revienne pour le mastering final.
GIOVANNI CECCARELLI – FERRUCCIO SPINETTI «Le Grand Michel» A Journey with Michel Legrand (Bonsaï Music / Idol / L’Autre Distribution)
 Intemporel Michel Legrand. Figure de notre patrimoine musical, le légendaire compositeur a laissé une œuvre riche et marquante qui ne risque pas l’oubli tant elle est régulièrement revisitée, notamment par une génération de jazzmen qui perpétuent l’héritage du maître en y apportant chacun sa patte sans pour autant trahir le legs initial. Après avoir salué dans ces colonnes le remarquable «Michel Legrand Stories» proposé il y a deux ans par le trompettiste et chanteur Nicolas Folmer (voir ici) entouré d’une impressionnante armada all-stars (avec cuivres, cordes et percussions), le duo formé par le pianiste Giovanni Ceccarelli et le contrebassiste Ferruccio Spinetti s’empare à son tour d’une douzaine de compos emblématiques du Grand Michel comme s’intitule leur nouvel album sous-titré «A journey with Michel Legrand».
Intemporel Michel Legrand. Figure de notre patrimoine musical, le légendaire compositeur a laissé une œuvre riche et marquante qui ne risque pas l’oubli tant elle est régulièrement revisitée, notamment par une génération de jazzmen qui perpétuent l’héritage du maître en y apportant chacun sa patte sans pour autant trahir le legs initial. Après avoir salué dans ces colonnes le remarquable «Michel Legrand Stories» proposé il y a deux ans par le trompettiste et chanteur Nicolas Folmer (voir ici) entouré d’une impressionnante armada all-stars (avec cuivres, cordes et percussions), le duo formé par le pianiste Giovanni Ceccarelli et le contrebassiste Ferruccio Spinetti s’empare à son tour d’une douzaine de compos emblématiques du Grand Michel comme s’intitule leur nouvel album sous-titré «A journey with Michel Legrand».
Cinq ans après un hommage sensible à Ennio Morricone (album « More Morricone »), autre figure incontournable des musiques de films, ces deux délicats Italiens se sont attelés avec le raffinement qui caractérise leur maîtrise du minimalisme musical, à une sélection d’oeuvres du bien nommé Legrand, depuis ses inoubliables collaborations avec le cinéaste Jacques Demy, jusqu’aux chansons écrites tant pour Nougaro que Ray Charles, sans oublier l’âge d’or d’Hollywood. On retrouvera d’ailleurs dans leur track-list trois morceaux déjà repris par Folmer et sa bande avec la présence sur les deux opus de l’inévitable batteur Dédé Ceccarelli (qui précisons-le n’a aucun lien de parenté avec son homonyme pianiste). Car eux aussi ont convié une belle brochette d’invités, avec pas moins de six chanteurs et chanteuses de renom qui se succèdent avec pertinence et élégance sur leur disque voulu plus comme une subtile recréation plutôt qu’une simple réinterprétation.
Passée l’entame sur la mythique et bouleversante B.O du film Un Eté 42, entre piano délicat et contrebasse chantonnante, on est ravi d’entendre la voix impeccable et adéquate du discret Jean Guidoni reprendre Le Cinéma de Nougaro (avec naturellement Dédé aux baguettes) dont les arrangements sont particulièrement réussis, avec un Fender Rhodes apportant une touche electro sur une rythmique tour à tour groovy puis bluesy. Il laisse le micro à un habitué du genre en la personne de David Linx soulignant la langueur de I will wait for you, thème écrit pour le cinéma de Demy comme la célèbre «chanson de Maxence» (You must believe in spring) interprétée avec charme par Chiara Civello, tandis que pour l’incontournable Chanson des Jumelles des Parapluies de Cherbourg, le piano change de mains mais reste italien avec un Enrico Pieranunzi qui s’amuse à cavaler avec maestria sur cet air ancré dans notre patrimoine mémoriel, entre swing échevelé et fines nuances romantiques. Autre invité instrumental, le flugelhorn de David Lewis alanguit encore par sa caresse La Valse des Lilas (Once upon a Summertime) quand Dédé revient soutenir de quelques balais feutrés Les Délinquants, que j’avoue ne pas connaître mais dont le feeling, avec notamment une contrebasse en majesté, en fait un très beau thème pour un trio de jazz. De bien délicats délinquants en tout cas ! Une contrebasse qui claque aussi ses notes sur le court instrumental Le Rouge et le Noir emprunté encore à Nougaro.
Côté vocal toujours, on découvre avec bonheur la voix soul-gospel de Jody Sternberg et son médium parfaitement timbré pour Love Makes the Changes, quant à l’inverse on adhère moins à la version des Moulins de mon Coeur chantée en anglais par Cristina Renzetti. Un pathos dont on a en fait un peu marre, mais où au final le piano très onirique réussit à nous emmener ailleurs.Ceci étant dit, la vraie pépite du casting réside sans doute dans l’interprétation de What are you doing for the rest of your life par Camille Bertault, un petit bijou où la jazzwoman parisienne tient magistralement les notes sans n’avoir rien à envier aux grandes divas américaines sur ce titre emblématique où le piano s’écoule en gouttelettes et où l’on aurait tout à fait bien vu le souffle d’une trompette, comme celle de Truffaz par exemple, avant que le duo de base conclut cet album intime et lumineux par la charmante mélodie de l’explicite I will say Goodbye.
CHARLOTTE REINHARDT «Fables Deluxe» (Naïve / Believe)
 En découvrant le nom de Charlotte Reinhardt sur la pochette du disque, on pourrait vite associer ce légendaire patronyme à du jazz manouche mais ce serait faire totalement fausse route, d’autant que son élégant graphisme artwork évoque clairement une forme d’onirisme poétique. On n’a cependant pas tout faux puisque la rayonnante artiste franco-espagnole retirée sur les hauteurs sauvages de la Cantabrie (Espagne), fille d’une mère gitane éminente prof de piano et d’un père anglais, est bel et bien la petite-nièce du grand Django. Entrée dès l’âge de treize ans au CNSM de Paris pour se former au classique et à la musique de chambre, la pianiste en a gardé toute l’exigence académique, mais sa soif d’exploration l’a vite fait naviguer du classique au lyrique, de la chanson au jazz, en passant par la danse et les musiques de film. Sous son nom, elle signera d’abord «Colors» en 2022, une suite d’improvisations qui s’écoutait déjà comme un carnet de voyages intérieurs, puis en 2023, l’album «Fables» inspiré de son immersion au cœur des montagnes ibériques, tout habité de grâce, de pureté et de liberté.
En découvrant le nom de Charlotte Reinhardt sur la pochette du disque, on pourrait vite associer ce légendaire patronyme à du jazz manouche mais ce serait faire totalement fausse route, d’autant que son élégant graphisme artwork évoque clairement une forme d’onirisme poétique. On n’a cependant pas tout faux puisque la rayonnante artiste franco-espagnole retirée sur les hauteurs sauvages de la Cantabrie (Espagne), fille d’une mère gitane éminente prof de piano et d’un père anglais, est bel et bien la petite-nièce du grand Django. Entrée dès l’âge de treize ans au CNSM de Paris pour se former au classique et à la musique de chambre, la pianiste en a gardé toute l’exigence académique, mais sa soif d’exploration l’a vite fait naviguer du classique au lyrique, de la chanson au jazz, en passant par la danse et les musiques de film. Sous son nom, elle signera d’abord «Colors» en 2022, une suite d’improvisations qui s’écoutait déjà comme un carnet de voyages intérieurs, puis en 2023, l’album «Fables» inspiré de son immersion au cœur des montagnes ibériques, tout habité de grâce, de pureté et de liberté.
Croisant son goût pour l’école française du début du XXe et notamment l’influence des Debussy, Fauré et Ravel, au jazz travaillé avec des pointures comme Daniel Yvinec ou Eric Légnini, tout en y ajoutant l’esprit elfique de la poésie islandaise d’un Olafur Arnalds, la pianiste s’inscrit dans la lignée de ses consoeurs que l’on cite régulièrement ici, de Hania Rani à Agnès Obel, et des nouvelles venues comme Marie Krüttli, Yumi Ito ou Naoko Nakata (toutes vues en piano solo au RhinoJazzs Festival) bien que la claviériste ne soit pas toujours en solo.
Pour ce parcours initiatique singulier et très personnel puisqu’il creuse au fond de ses propres mondes enfouis, Charlotte Reinhardt nous entraîne en effet sous l’armature formée autour d’elle par le violoncelle de Juliette Serrad, les guitares de Yannick Robert et la batterie de Franck Agulhon, dans un labyrinthe mélodique à la fois onirique et énigmatique, où chaque pièce proposée est en lien direct avec la nature sauvage où vagabonde son esprit d’évasion. Les titres d’ailleurs sont en ce sens très évocateurs, et cette version Deluxe gâtera ceux qui la découvriront puisque ce nouveau tirage est enrichi de quatre compositions inédites.
Entre bestiaire (Les Fauves, Trois Chevaux, Petit Fauve, Albatros), paysages ambiants comme Les Brumes et ses limbes vaporeuses, le Sable très mouvant et sa patte classique déliée telle une harpe, le trop bref Les Arbres où l’on pense à Satie, l’extatique Tres Mares, l’explicite El Laberinto de Angel ou encore le lent mouvement de Pasos Perdidos qui tient du conte féerique, voilà un canevas de dix-sept pièces assez courtes, pour se perdre dans la contemplation et se laisser scotcher par ces compos suspendues. Comme enfin sur Floating Blue au gré du rebond de la caisse claire, ou le climatique Soleil Filaments entre frétillements de cymbales, profondeur du cello et piano effleuré. Seule Lee Bluette avec une batterie plus nerveuse tire vers le post-rock avec une envolée de vocaux aériens, mais planant quand même…